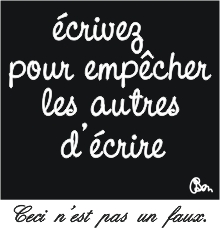 |
 |
mensueltous les 15 du mois |
|---|---|---|
Revue d’art et de littérature, musique
Directeur: Patrick CINTAS
Éditeur: Le chasseur abstrait Espaces d'auteurs: Valérie Constantin, Marta Cywinska,
Nacer Khelouz, Serge Meitinger, Régis Nivelle, Benoît Pivert, Oscar Portela, Robert Vitton. |
Au sommaire: |
HISPANOS DE AMERICA I
Antonio SEGUI - A vous de
faire l’Histoire ! La poésie,
déesse cachée du désir quand le silence se brise par Francisco AZUELA « La poésie est un jeu dangereux », dit Hölderlin ; c’est vrai si on en déduit qu’à la différence de la prose qui est construction, la poésie comme le jeu est émotion spontanée de l’âme. Tout le monde veut voir dans ses yeux de neige le feu de ses secrets les plus intimes. La poésie, ange déchu, est un spectre qui entraîne dans ses courses dolentes les blessures profondes d’un monde réduit au silence par la violence. Depuis les vertes et vastes forêts de l’Amazonie brésilienne, jusqu’au dernier réduit de l’horizon ibéroaméricain, la poésie est un fleuve de lumière, d’étoiles et de nostalgies. Elle perdure dans les coins de la dernière patrie blessée, dans les draps d’une femme à la beauté polyglotte et dans le visage d’un enfant qui agonise de faim dans les pays occupés et exploités. Elle nous chante son désir ardent et son destin, ses espérances et ses tristesses. C’est une arche d’or dans les cendres de l’abandon. Se souvenant au bord de l’énigmatique et sacré lac Titikaka, le Tahuantinsuyo, empire des quatre états des Incas de Cusco ; avec Chinchaysuyo au nord-est jusqu’à toucher le fleuve Ancasmayo à Pasto, en Colombie ; Antisuyo au nord-est des vallées subtropicales de la forêt amazonienne ; Contisuyo au sud-est, jusqu’au territoire bolivien et Tucumán au nord de l’Argentine. La poésie de ce temps souffre aussi de la vie misérable des runes ou mitimaes, considérés comme gens vulgaires, mortier de l’empire, soumis aux travaux obligatoires des mines, système de travail collectif, et les Yanaconas ou Yanakunas, domestiques issus des nations conquises. EN BOLIVIE, terre des beaux sommets enneigés : Sajama, Yllampu, Illimani, Mururata, Huayna Potosí et l’un des endroits les plus beaux du monde, le Salar de Uyuni, la poésie dut attendre le romantisme pour trouver le poète Ricardo José Bustamente (1821-1886) avec des œuvres comme « Amérique hispanique libérée ». Le modernisme avec le poète Ricardo Jaimes Freyre (1872-1933) : « Castalia bárbara », entre autres recueils. Le chantre des hauts-plateaux Franz Tamayo (1879-1956) : « Balada de Claribel », « Scherzo de Primavera », « Nuevos Rubayat », « Adonais », « La Prometheida », « Las Oceánica », « Epigramas Griego ». Gregorio Reynolds (1882-1947) : « El cofre de Psiquis », « Horas turbias », « Illimani ». Guillermo Viscarra Fabre (1900). Raúl Otero Reiche (1905). Les contemporains : Oscar Cerruto. Fernando Ortiz Sanz (1914). Jaime Sáenz (1921-1986) : « La muerte por el tacto », « Como una luz », « Eres visible ». Oscar Alfaro (1921-1963). Jaime Choque Mata(1927). Jesús Urzagasti(1941) : « Alabanza No. 2 al Gran Chaco ». Carlos Franck (1922) : « Bella por el cobalto », « Nunca sé dónde voy pero siempre llego ». Jorge Suárez. Pedro Shimose. Eduardo Mitre. Blanca Wiethüchter. Humberto Quino. Anibal Crespo Ross. Juan Carlos Orihuela. Jaime Taborga. Vicky Ayllón. Rubén Vargas. Juan Cristobal Maclean. Rodolfo Ortiz et Jessica Freudenthal. Amérique du Sud, Amérique ibérique, Amérique hispanique, Indo-Amérique : lumière naissante de la grande poésie de notre temps, signe astral qui s’appuie sur les vestiges splendides d’une culture antique : aztèque, maya, aymara, quechua, guarani et le hamac tropical, métis, sensuel et suant où respirent des yeux indiens, caraïbes, mulâtres, amazoniens et créoles, jusqu’au soleil qui illumine les altitudes et les longitudes du vertige, jungles brisées, angoissantes, étroites, profondes et escarpées, et la faune innombrable de nos latitudes en harmonie avec une flore qui échappe à toute classification en raison de sa diversité et de son abondance, où l’oeil de l’homme, le condor, l’aigle, le tigre, le jaguar, le flamand, le cerf des marais, le toucan, l’anaconda, admirent la splendeur de la nouvelle graine qui croît comme les sapins, les bouleaux, les fougères, les palmiers tropicaux, les pins, les peupliers, les saules, les magnolias, les orchidées de l’Amazone et l’anthurium rouge de la Martinique. La poésie est aussi la fille des déserts du
Nord, témoin du serpent bicéphale dévoreur d’hommes et de rêves. Ce n’est
pas la dorsale du coquillage de Delphes, c’est la lèvre de la fleur de
l’automne, flèche des sirènes. Ses rythmes contiennent toutes les
langues : langues à la prononciation libre, ouverte à sa musique
intérieure. Voix, styles, époques, éléments, signes, tonalités et sons
différents. C’est cette petite lumière matinale, flamme d’une chandelle
dans la cabane de la jungle obscure, symboles du lever et de la nuit.
C’est le paysage et l’ombre où naissent la lumière et la couleur qui
remplissent les yeux pour apercevoir la difficile progression du mystère.
Dans ce vaste horizon, on produit LA BELLE POESIE BRESILIENNE qui
traverse les distances et les sons, comme celle du poète Itabira, Minas
Gerais, Carlos Drumond de Andrade (1902), avec sa bombe :
« ...que es una flor de pánico... », « Sentimento
do mundo », « La rosa del pueblo ». Autres
grands : João Cabral de Melo Neto (1920-1999) : Thiago de Melo
(1926) : « Estatutos del hombre » et
« Silencio y palabra ». Vicente de Carvalho
(1866-1924) : « Pequenino Morto ». Le poète de
Río Vinícius de Moraes (1913-1980), compositeur, interprète et diplomate,
auteur de « Balada dos mortos do campo de concentração »,
« Recital de Mulher », « Rosa de
Hiroshima » et « Para vivir un gran amor ».
Autres poètes : Alfonso Avila. Haroldo de Campos. Alfonso Romano de
Sant’Anna. Marcio Sampaio. Elmo de Abreu Rosa. Paulo Mendes Campos.
Palmira Ayala. Antonio de Miranda. Nina Reis et José Gerardo Neres. LA POESIE ARGENTINE semble venir, par une image unique en son genre, de la Terre de feu en Patagonie, jusqu’à l’Aconcagua. En 1602, parut le poème « La Argentina », de Martín del Barco Centenera (1544-1605). Autres poètes : Luis José de Tejeda : « Coronas líricas » et « El peregrino en Babilonia ». Leopoldo Lugones (1874-1938). Oliverio Girondo (1891- 1967). Macedonio Fernández (1874-1952). Jorge Luis Borges (1899-1986), considéré comme un des poètes les plus importants et des plus innovateurs de la littérature latino-américaine et universelle du XXe siècle. Alfonsina Storni (1892-1938). Julio Cortazar (1914). Roberto Juarroz (1914) : « Poesía vertical ». Emma de Cartosio : « Madura soledad », « El arenal perdido ». Juan Gelman (1930) : « Violín y otras cuestiones », « El juego en que andamos », « Velorio del solo y Gotán ». Rubén Tiziani : « El cuerpo todo ». Autres poètes : César Fernández Moreno. Alejandra Pizarnik. Saúl Yurkievich. Noé Jitrik. Daniel Malaca. Diana Bellessi. Manuel Lozano. José Carlos Orihuela. Carlos Barbarito. Silvia Longoni. Cristina Castello. Gabriel Impaglione. Gabriela Bruch. Luis Ricardo Furlan. Ana Guillot. Olga Lonardi. Anamaría Mayo. Juan Pomponio et Silvia Spinazzola. LA POESIE CHILIENNE, depuis La Araucana d’Alonso de Ercilla (1533-1594), qui lutta pour la conquête du Chili, nation des cordillères enneigées et du désert. Gabriela Mistral (1889-1957). Vicente Huidobro (1893-1948). Pablo de Rokha (1894-1968). Pablo Neruda (1904-1973), à qui, à l’occasion de son centenaire, un groupe de poètes dirigé par José Gerardo Neres consacra un hommage sous le patronage de l’Unesco, réunissant dans un site Internet les textes de plus de mille poètes de trente-sept pays. Autres poètes : Juvencio Valle (1900). Nicanor Parra (1914). Gonzalo Rojas (1917) : « La miseria del hombre, Fragmentos y contra la muerte ». Violeta Parra (1917-1967). Fernando Alegría (1918) Miguel Arteche (1926). Rolando Cárdenas (1933) : « En el invierno de la provincia ». Jorge Teillier (1936) : « Poemas para René Guy Cadou ». Elías Letelier. Genaro Albaíno. Jorge Alvarez. Raúl Zurita, Andrés Urzua de la Sota et Luis Arias Manzo. LA POESIE URUGUAYENNE, terre ondulante de lames poétiques sans sommets jusqu’à Paysandú et ses lagunes : La noire, celles des morts. Grande culture charrúa qui vit naître Julio Herrera y Reissig (1875-1910). Mario Benedetti (1920) : « Habanera », « Solo mientras tanto », « Consternados rabioso ». Le comte de Lautréamont, franco-uruguayen : « Les Chants de Maldoror ». Dans le courant avant-gardiste, la poétique moderniste avec l’oeuvre érotique de Delmira Agustini et la sensuelle de Juana de Ibarbourou, appelée Juana de América, Juana de la Naturaleza, comme elle aimait s’appeler elle-même. Milton Schinca (1926) : « Aldeas de Vietnam ». Autres poètes : Idea Vilarino : « Playa Girón ». Amanda Berenguer : « Circunstancia ». Ida Vitale : « Pesadilla ». Saúl Yacovski : « Comprueba tu fuego » et Roberto Bianchi. LA POESIE PARAGUAYENNE : Elvio Romero (1927-2004) qui rendit son dernier souffle au matin du 19 mai à Buenos Aires, à l’âge de 78 ans, avec ses souvenirs des fleuves Pilcomayo et Paraná, s’éternisant maintenant son anthologie « Contra la vida quieta ». Autre des grands absents de cette année, Augusto Roa Bastos (1917-2005) : « El ruiseñor de la aurora y otros poemas ». Miguel Ángel Fernández (1938) : « Oscuros días », « Los círculos vacíos ». Roque Vallejos (1943) : « Pulso de sombras » et « Los arcángeles ebrios ». Autres poètes : Francisco Pérez-Maricevich et Miguel Ángel Fernández. LA POESIE PERUVIENNE, (Pérou, terre de Machu Pichu et du Chavin de Huantar), de guayacanes, géraniums, eucalyptus, chênes, gardénias, calandres et mouettes. Cristóbal de Molina, le cuzqueño : « Fábulas y ritos de los incas » (1573). José Santos Chocano (1875-1934) : « Alma América). José María Eguren (1874-1942). César Vallejo (1892-1938) : « Los heraldos negros », « Trilce » et « Poemas humanos ». Washington Delgado (1927) : « Destierro por vida ». Javier Heraud (1942), le poète soldat asassiné par l’armée en 1963 à 21 ans, au milieu du fleuve Madre de Dios, face à la ville de Puerto Maldonado. Ses livres : « El viaje », « Estación reunida », « Poemas de la tierra », « Viajes imaginarios », « El Río » et « Explicació ». Autres poètes : Severo Sarduy (1937-1993). José Watanabe. Carlos Garrido Chalén. Frank Otero Luque. Anthony James Ramos Vargasy. Samuel Brèjar, résident en France et directeur des revues « Rimbaud Revue » et « Neruda Internacional ». LA POESIE EQUATORIENNE, comme d’autres, vient de l’époque préhispanique de la civilisation inca, unie au Chimborazo, la Sultana de los Andes. Les premiers poètes de la colonie au XVIIe siècle. Jacinto de Evia (1629- ?). Le XVIIIe : Juan Bautista Aguirre (1725-1786). José Joaquín de Olmedo (1780-1847) : « Victoria de Junin ». Autres poètes : Miguel Donoso Pareja. César Dávila Andrade. Edgar Ramírez Estrada. Jacinto Romero Espinoza. Hugo Salazar Tamariz. Jorge Enrique Adoum. Carlos Arauz. Jorge Torres Castillo. Agustín Yulgarín. Marieta Cuesta. Sara Beatriz Vanegas Covena et Fernando Cazón Vega. Dans LA POESIE COLOMBIENNE, où l’on
sent encore le murmure de la jungle et le tonnerre forestier, l’odeur du
frêne, le saule, les hortensias, le cyprès et le marabout : Juan de
Castellanos : « Elegías de varones ilustres de
Indias » (1589). José Asunción Silva (1865-1896). Julio Flórez
(1867-1930). Porfirio Barba Jacob (1883-1942). José Eustasio Rivera
(1888-1928). Carlos Martín (1914). LA POESIE VENEZUELIENNE, à suivre comme un écho blessé dans l’univers de la carte géographique, entre les cèdres, le gui, bromelias et brumes : le poème épique de Jorge de Herrera. Andrés Bello (1781-1865) écrivain, politicien, grammairien et poète néoclassique à la versification soignée : « A la agricultura de la zona tórrida », « La oración por todos ». Guillermo Valencia (1873-1943). José Antonio Ramos Sucre (1890-1930). Andrés Eloy Blanco (1896-1955poète, conteur, dramaturge, journaliste, biographe, orateur et essayiste : « El solitario de Santa Ana » et « Walkyria ». Miguel Otero Silva (1908-1985) : « Agua y cauce ». Vicente Gerbasi (1913-1992), figure centrale du groupe Viernes ; sa plénitude poétique apparaît en deux moments significatifs : « Mi padre, el inmigrante » et « Los espacios cálidos ». Meira Delmar (1921-) : « Secreta isla », « Alba de olvido », « Encuentro », « Verdad del sueño. Fernando Paz Castillo : « Dios, el alma, la muerte ». Autres poètes : Luis Pastori. Juan Calzadilla, Edmundo Aray. Ludovico Silva. Mary-Lu Sanes. Irene Flores. Jaime López Sanz. Josefina Calles. Antonieta Valentina Bustamante. Wilfredo Carrizales. Luis Gilberto Caraballo et Daniuska González González. POESIE PANAMEENNE : Darío Herrera (1870-1914) : Ricardo Miró (1883-1940) : Rogelio Sinán (1904-1994). Autres poètes : Diana Morán. Ramón Oviedo. Bertalicia Peralta et Dimas Lidio Pitty. POESIE COSTARICAINE : Aquileo Echeverría (1866-1911), ami de Rubén Darío, avec qui il collabora à la revue La Unión d’El Salvador, en 1884. Jorge DeBravo (1938-1967 : « Nosotros los hombres ». Autres poètes : Alfonso Chase. Laureano Albán. Ana Antillón et Marco Aguilar. POESIE NICARAGUAYENNE : Rubén Darío (1867-1916). Joaquín Pasos (1915-1947). Pablo Antonio Cuadra (1912). Ernesto Cardenal (1925- ). María Amanda Rivas : « Emergiendo ». Carlos Martínez Rivas : « La insurrección solitaria ». Autres poètes : le poète de la vallée de Matapalos, Estelí, José Leonel Rugama Rugama, (1949), qui mourut dans un combat contre la garde somosienne. Gioconda Belli. Beltrán Morales. Vidaluz Meneses : « Raíces que rompen el tiesto ». POESIE SALVADORIENNE, baume de cèdre, kaoba, bâton de rose, fils et tissus de coton, odeur de café dans la montagne mère des Andes centroaméricaines : Roque Dalton (1933) : « El gran despecho ». Alfonso Quijada (1940) : « Sagradas Escrituras ». En HONDURAS, terre des Garífunas, la poésie de Roberto Sosa (1930). Oscar Acosta. Rigoberto Paredes ; tributaires comme le fleuve Ulua del Caribe et habitants des montagnes de Comayagua et du Merendón. Autres poètes : Claudio Barrera. Clementina Suárez. Alexis Ramírez. José Luis Quesada. Ricardo Maldonado. Horacio Castellanos Moya et Franzisco Yutzil Azuela Erazo, hondureño-mexicano. POESIE GUATEMALTEQUE, terre sacrée du Popol Vuh, du lac Atitlán, de la cordillère des Cuchumatanes, du Petén, de l’acropole de Tikal et des volcans Tajumulco et Tacaná, avec ses fleuves Motagua, Usumacinta et de la Pasión y sa belle stèle de Quiriguá et son quetzal, masque de Chichicastenango et sa culture quiché. Estela Kaminaljuyú. Luis Cardoza y Aragón (1901-1992) : « Soledad ». Alaide Foppa (1911-1981). Otto René Castillo, poète soldat mort en combattant les FAR, en l967 : « Viudo de mundo ». Marco Antonio Flores (1937) : « La voz acumulada » et « Muros de luz » et Raúl Leiva. POESIE BELIZIENNE : bois de palisandre, citriques et créoles. Poètas : Evan X Hyde (1947). Edison Coleman : « Esta es mi tierra ». Le poème créole « Dis da me » de Phillip Lewis. En anglais, de Milton Arana : « Birth of a nation ». Leroy Young, poète créole et rasta : « The Grandmaster ». La nouvelle poésie de Belize : « Generation X » (1999) et « Made in Pink Alley » (1999). Amado Chan, poète bilingue, d’ascendance hispanique et orientale : « Speak to Me háblaME » (1999), « Make de Monarch Blusa » (2001), poésie de tradition anglaise espagnole. LA POESIE MEXICAINE : Chilam Balam, livre sacré maya, Yucatán, est un monument de la littérature indigène de notre Amérique. México-Tenochtitlán, la vallée de Anahuac, les atlantes de Tula, avec leur cordillère néo-volcanique et son plateau, ses volcans Orizaba, Popocatepetl et Iztaccihuatl ; massifs et montagnes des Chiapas. Olmecas, zapotecas, chichimecas, le Tajín et le Monte Albán, Oaxaca. Les náhuatl. Treize poètes du monde aztèque. Le plus important est le mythique poète roi Nezahualcóyotl (1402-1472). Il y a aussi de nombreuses compositions en náhuatl, la plupart de la période mexicaine aztèque, dans les genres : cuícatl ou chants ; teocuícatl ou chants divins ; xochicuícatl ou chants fleuris ; icnocuícatl ou chants de la pensée ; cuecuechcuícatl ou chants érotiques ; huehtlahtolli ou discours de l’ancienne parole ; teotlahtolli ou discours religieux ; ihtoloca ou narrations historiques et légendaires. La littérature náhuatl, langue des astres, est riche de belles métaphores et dotée d’une grande variété d’expression.
« Ainsi Nezahualcóyotl s’entretenait en
jouant, Bernardo de Balbuena (¿1561 ?-1627). Soeur Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Juan Valle (1838-¿1865 ?). Salvador Díaz Mirón (1853-1928). Manuel José Othón (1858-1906). El Duque Job, Manuel Gutiérrez Nájera(1859-1895). Amado Nervo (1870-1919). José Juan Tablada (1871-1945). Enrique González Martínez (1871-1952). Rafael López (1873-1943). Ramón López Velarde (1888-1921). Alfonso Reyes (1889-1959). José Gorostiza (1901-1973) : « Muerte sin fin ». Jorge Cuesta (1903-1942). Xavier Villaurrutia (1903-1950). Gilberto Owen (1905-1959). Octavio Paz (1914-1998) : « Piedra de sol ». Efraín Huerta (1914-1982). Alí Chumacero (1918). Margarita Paz Paredes(1921). Rubén Bonifaz Nuño (1923). Rosario Castellanos (1925-1974). Jaime Sabines (1926-1999). Tomás Segovia (1927). Autres poètes : José Carlos Becerra (1936-1970). Francisco Cervantes (1938). José Emilio Pacheco (1939). Homero Aridjis (1940). Jaime Labastida. Juan Bañuelos. Oscar Oliva. Raúl Garduño. Eduardo Lizalde. Hugo Gutiérrez Vega. Francisco Azuela (1948) : « El Maldicionero », « El Tren de Fuego », « Son las cien de la Tarde », « Ángel del Mar de mis sueños » « Antología poética : un recorrido interminable 1972-2005 » et un CD-Rom en six langues : « Les Printemps des poètes ». Telma Nava. Ramón Iván Suárez Caamal. Alejandro Aura. David Huerta. Elsa Cross. Humberto Garza. Benjamín Valdivia. Antonio Leal. Jeannette Clariond. Lina Zerón. José Ángel Leyva et Demetrio Vázquez Apolinar. L’AMERIQUE CENTRALE isthmique annexée par le Mexique, Panama et la Colombie, l’Amérique centrale insulaire, composée par les Antilles : Cuba, L’Espagnole, la Jamaïque et Puerto Rico, les petites Antilles : les îles de Barlovento et de Sotavento. Là se trouve la mer Caraïbe qui est la méditerranée américaine. Océan Pacifique, Golfes et Océan Atlantique jusqu’à l’orée de la poésie espagnole et portugaise.. LA POESIE CUBAINE : José María Heredia (1803-1839) : « En el Teocalli de Cholula » et « A Niágara ». José Martí (1853-1895).Nicolás Guillén (1902-1989). José Lezama Lima (1910-1976). Roberto Fernández Retamar (1930). Carlos Manuel Puebla, poète et compositeur révolutionnaire du golfe de Guacanayabo (1917-1989) : « Juglar de la Era Moderna » « El Cantor de la Revolución », autor de « Hasta siempre Comandante ». Cintio Vitier (1921-) : « Vísperas », Nupcias », « Epifanía ».Autres poètes : Luis Felipe Rojas. Rigoberto Rodríguez Entenza et Alfredo Saladívar. POESIE DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE : Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897). Pedro Henríquez Ureña (1884-1946). Manuel del Cabral (1907-1999), sa poésie afro-antillaise dans « Doce poemas negros » et « Trópico negro », avec le cubain Nicolás Guillén sont les représentants de la poésie noire. Pedro Mir (1913-2000). L’ECRIVAIN PORTORICAIN René Marqués affirme son nationalisme face à l’hégémonie des USA dans « La víspera del hombre » (1962). Marcos Rodríguez-Frese : « Todo el hombre ». Rosario Ferré. Reynaldo Marcos Padua et Jaime Carrero. POESIE HAÏTIENNE : entre combats de coqs et comme partie des Antilles, Claude McKay. Derek Walcott (1930) : « Otra vida », « Uvas de mar », « El reino de la manzana estrellada », « El viajero afortunado », « Verano », « El testamento de Arkansas » et « Omeros ». POESIE ESPAGNOLE : Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), considéré comme une des figures fondamentales de la littérature universelle, ainsi que son roman « Don Quijote de la Mancha ». Rodrigo Díaz de Vivar, connu comme le Cid, auteur de « Cantar de mío Cid » (écrit aux environs du XIIIe siècle). Juan Ruiz (c. 1283-c. 1350), connu comme l’archiprêtre de Hita, auteur de « El buen amor ». Gonzalo de Berceo (1198 ?-1264 ?), poésie libertine et vagabonde. Autres poètes : Íñigo López de Mendoza, marquis de Santillana. Juan de Mena. Jorge Manrique : « Coplas a la muerte de su padre ». Garcilaso de la Vega (c. 1501-1536). Francisco de Quevedo y Villegas. Lope de Vega. Antonio Machado (1875-1939) et son frère Manuel. Miguel Hernández : « El rayo que no cesa ». Pedro Salinas (1891-1951) : « La voz a ti debida ». Vicente Aleixandre (1898-1984). Rafael Alberti (1902-1999). León Felipe. Manuel Altolaquirre (1905-1959). Blas de Otero (1916-1979). Luis Ríos. Félix Grande(1937 ). Clara Janés (1940) : « Las estrellas vencidas », « Límite humano », « En busca de Cordelia », « Poemas rumanos » Antología « personal » « Vivir », « El libro de los pájaros » « Arcángel de sombra », « Los secretos del bosque ». Angela Reyes. Manuel Quiroga Clérigo et Juan Ruiz de Torres. POESIE PORTUGAISE : Luís Vaz de Camões (c. 1524-1580), un des plus grands poètes, son chef-d’oeuvre, « Os Lusiadas » (Les Lusiades, 1572), est considéré comme le grand poème épique portugais. Almeida Garrett, son recueil érotique « Fólhas Caídas ». Fernando Pessoa (1888-1935) et Miguel Torga, pseudonyme de Adolfo Correia da Rocha. J.J. Parreira. Luisa Ribeiro. La Editora Universitaria de Lisboa a publié le livre de poésie contemporaine « Um Mundo no Coraçao », du poète français Jean-Paul Mestas, édition bilingue 2002 en portugais et en français qui réunit 82 poètes de 57 pays, dont moi-même. Si intimiste soit-elle (roman, conte, essai) la prose recourra toujours à l’argument, c’est son essence. La poésie rejette l’argument, même si elle intègre la labeur et les sentiments humains. Telle cette poésie ou phrase poétique :
« Oh, Hélène
(Carlos Franck) Voici toute l’histoire, toute la culture, la mythologie que le monde occidental a reçue de la Grèce. La beauté originelle d’Hélène, l’immortalité et l’amour dans l’étreinte de la fraternité humaine. La poésie est lumière immédiate comme l’éclair qui illumine les ténèbres. Il est inévitable de n’avoir pas tout dit. Mais on a parlé des poètes et des circonstances de l’héritage, de la culture, la profondeur et la latitude qui ont submergé. Beaucoup de ces poètes ont contribué à faire de la poésie une des plus grandes richesses du panorama hispano-américain du XXe siècle, et comme je l’ai écrit dans mon prologue au livre « La noche oscura » de l’écrivain bolivien Pablo Mendieta : les oiseaux volent toujours plus haut en accord avec la direction des vents. Francisco Azuela
|
Rubriques: |
|||
|
Numéro coordonné
par Marie SAGAIE-DOUVE & Patrick CINTAS dans le cadre de l'Atelier de traduction animé par Marta CYWINSKA PREMIERE PARTIE:
HISPANOS
DE AMERICA I Traductions de Corollaire:
Daniela
HUREZANU
Assia Djebar, Julia Kristeva,
Joseph Conrad, Joseph Brodsky, Samuel Beckett, Vladimir
Nabokov...
La langue maternelle et les sources de la création La lengua materna y las fuentes de la creación Textes:
Cristina
CASTELLO
Franzisco Yutzil AZUELA
ERAZO
Giovanna MULAS Silvia FAVARETTO Gabriel IMPAGLIONE Antonio LEAL Pablo MENDIETA Ana ROMEO MADERO Ignacio M. SÁNCHEZ PRADO Livres:
traduits en français Francisco AZUELA
Panthéon des chats illustres Manuel RUANO Les chants du grand Embaumeur Ulises VARSOVIA Annonciation Carlos BARBARITO Radiation de fond Oscar PORTELA Clairobscur Libros:
traducidos al castellano Marie
SAGAIE-DOUVE
efemérides Rodica DRAGHINCESCU El polén de las lenguidiomas Régis NIVELLE Saetas! Marta CYWINSKA Astrolabio
DEUXIEME PARTIE:
COLLECTIONS
Que sont les collections? Ouvrir la fenêtre Collection Chasseur abstrait
Patrick CINTAS
alba serena III & IV poésie ESPACES
D'AUTEURS Que sont les espaces d'auteurs? Ouvrir la fenêtre Chronique du
péristyle
Tee-shirt et différenceSerge MEITINGER Je voudrais
prolonger ici le commentaire qu'accorda généreusement Daniela Hurezanu à mon intervention, un peu
ancienne déjà, intitulée Universel donc singulier.
Trop heureux... s’ils savaient!Sous la vaste
véranda, le concert s’apprêtait avec ce qui m’apparut comme une vraie
débauche de matériel et de moyens techniques : batterie complète, guitares
électriques, synthétiseur et forte sono.
L'illisible
signifiant
La narration de l'inconscientRégis NIVELLE Ceuta, Melilla,
Bobigny, Clichy, etc. .. Les bordures s’embrasent. Du coup, la langue
putanée recule devant l’opéra d’une sémiotique corporelle de la révolte
qui dit chômage, précarité, discrimination raciale, misère sociale ; Le
pouvoir aveugle, parle lui, en bon colonial, d’agissements terroristes et
de racaille...
François RICHARD
. "il y eut les fois où je parlais pour supporter
l'effacé..."
Extrait de Esteria Le zinc
Le zinc est le
parlement du peuple:Robert VITTON L'ânier
Je promène les enfançons... Les croulants suivent. Mon âne est une ânesse. Lola, je l’appelle, en souvenir de l’âne Lolo du Père Frédé, Frédé du Lapin à Gill. Le kiosquier
Tu t’imagines que je ne vois pas ton manège. Mais quelle mouche pique cette bourrique bâtée? Le boulanger-pâtissier
Je suis dans le pétrin ! C’est vrai, mon père a des airs de Raimu. En vieillissant, de plus en plus. Le facteur
Un cailloux... Deux, trois cailloux. Des tonnes de cailloux ! Du gravier, des fossiles... ANTHOLOGIES
Que sont les anthologies? Ouvrir la fenêtre Serge MEITINGER Rachid DZIRI Francisco José SANTOS Kathy FERRÉ Cristina CASTELLO Étienne CAVEYRAC Pierre BRANDAO Kacem LOUBAY Éric DUBOIS Katia HACÈNE Yemele JANVIER Robert VITTON Robert BERROUËT-ORIOL Philippe BRAY Jean-Michel BOLLINGER Oswaldo ROSES Guillaume VIVIER |
Espaces d’auteurs
Valérie Constantin, Marta Cywinska,
Nacer Khelouz, Pascal Leray, Serge Meitinger, Régis Nivelle, Benoît
Pivert, Oscar Portela, Robert Vitton.
Collections
Collection Hors série
Collections du Chasseur abstrait Hors collection Numéros spéciaux
Vous souhaitez collaborer avec nous
à un numéro spécial sur un thème
contactez-nous Auteurs
Les auteurs de la
revue
minibiographies oeuvres choisies Anthologies
Oeuvres choisies
des auteurs de la revue classées par genre. Galeries d’art
Galeries virtuelles
avec ou sans commentaires. Musique
Musique
et chansons Infos
Livres
reçus
parutions évènements, sites Sommaires précédents
Tous les numéros de la
RAL,M
depuis avril 2004 date de sa création. Boutique
La boutique du Chasseur
abstrait.
Sites
Les sites du Chasseur
abstrait.
|
||||
2005 Revue d'art
et de littérature, musique
publiée par Patrick
CINTAS - Le chasseur abstrait - Venta del lorquino ALFAIX 04280 Los Gallardos (Almería)
Espagne - Le 15 du mois - Direction: Patrick CINTAS - Copyrights: - Le site: © Patrick CINTAS. - Textes, images,
musiques: © Les auteurs. - Logiciel: ©
SPIP.
Dépôt légal: AL-44-2004 - ISSN: 1697-7017 - Junta de Andalucía - España |


Un deuxième numéro HISPANOS DE AMERICA, en 2006, témoignera de l’avancée des travaux... et de l’engouement suscité par cette tentative de rapprochement d’une Amérique aux sangs mêlés dont Francisco AZUELA témoigne dans son excellente Rotonda de los gatos ilustres.